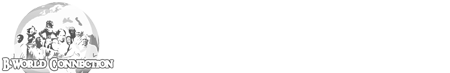TEMOIGNAGE: ''L'AMERIQUE N'AIME PLUS BARACK OBAMA''
TEMOIGNAGE: ''L'AMERIQUE N'AIME PLUS BARACK OBAMA''
Barack Obama et une certaine idée de l’Amérique
Ca y est, l’Amérique n’aime plus (autant) Barack Obama. Cela s’est passé en six mois, ou moins, dans un contexte de crise économique majeure, ou relativement majeure, dont personne ne comprend encore les racines et les ressorts. Puisque la situation est si volatile, et puisque le capital de sympathie d’un Président décidément inventif reste élevé dans le monde entier, force est de se poser la question : comment l’enfant prodige a-t-il déçu si vite ses concitoyens ? En analysant les faits et en regardant autour de moi, je ne parviens qu’à une conclusion : Barack est le dirigeant d’un pays qui ne le méritait pas.
Quels ont été les principaux facteurs de la désaffection, ces derniers mois ? Je ne pense pas que la gestion de la crise bancaire qui a précipité un krach mondial AVANT son élection soit un facteur majeur, d’abord parce que personne, y compris une brochette de prix Nobel d’économie et d’anciens directeurs de la Cour des comptes américaine, n’y entend goutte. Certes, on sait que les principaux acteurs bancaires, dans le monde entier, se sont grossièrement enrichis sur la base d’investissements factices et de spéculations aberrantes ; on sait aussi qu’à de rares exceptions près ils ne seront jamais tenus responsables de leurs actes. Quant aux guerres dont Barack Obama a hérité, leur gestion semble plus ou moins rationnelle, ne serait-ce que parce qu’elle n’est plus entourée par la stridulence chauviniste des années Bush. Alors, quoi ?
Barack a déplu à une majorité d’Américains en disant que la police avait agi «stupidement» dans le cas de l’arrestation d’un professeur noir de Harvard accusé d’avoir cambriolé son propre domicile. Même si sa gestion d’une affaire particulièrement grotesque aurait dû susciter une large approbation - il a invité le dignitaire noir, par ailleurs très enclin à la polémique facile, et le flic de service, pas précisément un expert en psychologie raciale, à prendre une bière ensemble à la Maison Blanche -, cette affaire est restée en travers de la gorge de beaucoup d’Américains. Dans un pays où la délation peut atteindre des niveaux surprenants - rappelons la commission sur les «activités antiaméricaines» de McCarthy, ou la lettre anonyme qui avait conduit le FBI à refuser un visa d’entrée à… Albert Einstein -, le Président n’est pas supposé penser que les appels anonymes au 911 (urgences) et l’intervention musclée de la maréchaussée peuvent créer plus de problèmes qu’en résoudre. Il y a encore quelques jours, deux jeunes flics du New Jersey ont appréhendé un homme qui se baladait sous la pluie dans un quartier plus que modeste, pour la seule raison qu’un citoyen lui avait trouvé l’air suspect. «Quel est votre nom ?» a demandé la fliquesse de 24 ans. «Bob Dylan», a répondu le dangereux vagabond, qui faisait juste une promenade entre deux concerts. «Bob quoi ?»
Un détail qui est mal passé, aussi : en mars, les responsables de la sécurité nationale ont lourdement fait savoir qu’ils s’inquiétaient de la possible recrudescence des activités d’extrême droite, racistes, fascistes, antisémites. Hourvari chez les adorateurs de la momie anticommuniste McCain : comment oser dire une chose pareille ? En quelques semaines, pourtant, un déséquilibré a attaqué le musée de l’Holocauste à Washington, tuant le gardien, noir ; un autre cinglé a abattu un médecin connu pour ses vues libérales sur l’avortement ; les publications incitant à la haine des Noirs et des Juifs se multiplient impunément. Et c’est sans même parler de la multitude de crimes de droit commun qui sont ici classés comme tels mais qui présentent de toute évidence des composantes machistes ou suprémacistes.
Autre péché commis par Barack Obama est d’avoir répété ces derniers mois, plus haut et plus fort que ses prédécesseurs démocrates, que le système de couverture sociale américain devait être révisé de fond en comble. Cette hydre monstrueuse, qui coûte des milliards de dollars à l’Etat fédéral, qui inflige une précarité scandaleuse même à ceux qui cotisent à des assurances privées aux tarifs exorbitants et qui tire tendanciellement le niveau des soins médicaux américains vers le bas, demeure l’un des éléments les plus irrationnels et destructifs du débat politique américain. Il y a quelques mois, un ami de notre famille, pas du tout immigrant illégal, issu de la classe moyenne la plus respectable, s’est vu diagnostiquer une leucémie terminale ; son assurance, puis celle de ses parents, ont refusé de couvrir les frais d’hospitalisation ; il est mort, et ses proches ont dû ouvrir une souscription publique pour couvrir les centaines de milliers de dollars réclamés par l’hôpital. Presque chaque foyer aisé aux Etats-Unis a une histoire similaire, et pourtant la seule mention du concept «couverture sociale universelle» transforme le plus pondéré de vos hôtes en outlaw vociférant et brandissant la Remington rouillée de son arrière-grand-père.
Barack Obama, comme Bill Clinton en son temps, est en train de se faire rouler dans la farine par son propre parti. En période d’élection, tout le monde verse des larmes de crocodile sur l’état lamentable de la santé publique - ou sur le fait, comme le rappelait l’hebdomadaire Newsweek il y a peu, que les Etats-Unis ont cinquante fois moins de trains à grande vitesse que la Chine, quarante fois moins que le Japon, trente fois moins que l’Allemagne ou la France. Mais il y a des idées qui ont la peau dure au pays de Thomas Jefferson : autant la perspective d’interdire la vente libre d’armes automatiques semble «liberticide», autant la prétention à apporter une certaine logique à un système de santé chaotique est perçue comme une tentative d’instauration d’un «socialisme marxiste» dont le spectre, aussi hallucinant que cela puisse paraître, continue à faire peur soixante ans après.
Les Etats-Unis d’Amérique sont sans doute le seul pays au monde où les gens sont prêts à prendre les armes parce que quelqu’un a osé dire : «Même santé pour tous !» Au-delà des sujets d’actualité, néanmoins, Barack déplaît aux Américains blancs, conservateurs ou vaguement progressistes, cette cohorte immense des suburbs (banlieues) et des small towns (petites villes). Il ne brandit pas assez le drapeau américain. Il compte nombre de Noirs et de Juifs dans son équipe. Mais surtout, il est une contradiction vivante de l’imagerie américaine traditionnelle : il n’est pas un héros de Larry McMurty, il ne prétend pas travailler dur dans son ranch - comme le pathétique George W. s’escrimant sur quelques broussailles avec des gants de cow-boy pour une photo-op, ou se prenant une pelle en VTT -, il est le tout premier président - même Jimmy Carter tenta de le faire, très brièvement - à ne pas essayer de jouer les machos américains. Et cette image d’un Noir doté de diplômes, citadin et hawaïen, plus à l’aise sur un campus ou sur une plage que dans un campement de chasseurs ou une salle de bowling, irrite profondément nombre d’Américains. «Go West, Mr. President, to America’s wilderness», n’hésitait pas à exhorter une dépêche d’Associated Press en date du 16 août 2009. Allez à l’ouest, au Far West, monsieur le Président. Sous-entendu : vous en avez de moins grosses que nous. Cette dépêche devrait être décortiquée dans toutes les écoles de journalisme du monde, d’ailleurs. Parce qu’elle montre l’invasion de l’information par l’idéologie, c’est-à-dire l’une des grandes raisons pour lesquelles les gens ne font plus confiance à la presse. «Ce n’est pas le Marlboro Man», note cette dépêche signée Liz Sidoti - une femme, mais d’origine italienne… Une femme essayant de s’imposer dans un contexte machiste, peut-être.
Et nous touchons là au cœur du problème, à la fantasmagorie nationale dans laquelle vivent tant d’Américains, à ce mirage de toughness (détermination, couillitude) d’une nation qui est déjà dominée démographiquement par l’obésité et atteinte d’une inquiétante propension à rester couchée devant un téléviseur pendant vingt heures d’affilée.
Paradoxe, donc : un homme qui personnifie de manière exemplaire l’idéal américain n’est pas jugé assez américain par ses pairs. Il ne porte pas de santiags. Il n’aime pas affecter l’accent rural du redneck de base. Il est à l’aise en dehors des Etats-Unis. Il ne shoote pas les élans depuis un hélicoptère comme Sarah Palin. Il n’est pas fana de golf. Il ne pense pas que pêcher la truite est l’occupation la plus fantastique qui soit, notamment pour le fait que 90 % des rivières américaines sont plombées à mort par les rejets industriels. Il ne prétend pas être ce qu’il n’est pas.
Et quant à cette imagerie de l’Amérique dotée des plus gros roustons au monde, juste un détail : quand Barack Obama est finalement «allé à l’Ouest», emmenant sa famille au parc national de Yellowstone, il était accompagné d’une interpretive park ranger. Littéralement, «garde forêt interprète». J’ai vérifié sur le site des parcs nationaux américains. C’est en effet une profession qui existe. Elle consiste à «interpréter» la nature pour les visiteurs. Et après, ils diront que Barack est un citadin qui aime la plage…
A LIRE AUSSI:USA. SANTE: LA REFORME SE TRANSFORME EN DERAPAGES RACISTES