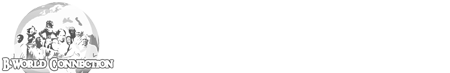Alain Mabanckou contre la malédiction de l’homme noir
Alain Mabanckou contre la malédiction de l’homme noir
 Trente ans après le ‘Sanglot de l’homme blanc’ de Pascal Bruckner, l’écrivain Alain Mabanckou lance un pavé en cette rentrée littéraire de janvier avec ‘Le Sanglot de l’homme noir’, où il renvoie dos à dos les discours victimaires et accusateurs sur la « question noire ». Un point de vue tranché sur la situation des Noirs en France et celle de l’Afrique dans le monde, nourri d’expériences personnelles et de littérature… Rencontre.
Trente ans après le ‘Sanglot de l’homme blanc’ de Pascal Bruckner, l’écrivain Alain Mabanckou lance un pavé en cette rentrée littéraire de janvier avec ‘Le Sanglot de l’homme noir’, où il renvoie dos à dos les discours victimaires et accusateurs sur la « question noire ». Un point de vue tranché sur la situation des Noirs en France et celle de l’Afrique dans le monde, nourri d’expériences personnelles et de littérature… Rencontre.
Comment avez-vous décidé d’écrire cet essai ?
Après avoir vécu en France (plus de 17 ans) et aux États-Unis depuis le début des années 2000, j’ai observé ce que certains appellent la « communauté » noire. Ce livre est en quelque sorte le fruit de cette observation. J’ai voulu aborder la question en partant de mon expérience et sous forme de brefs récits qui essaient de comprendre le sanglot de l'homme noir et sa posture d'éternelle victime.
Vous évoquez le fameux débat sur l’identité nationale qui a agité la France entre 2007 et 2009. Qu’en avez-vous retenu ?
 J’ai retenu de ce débat que la France traversait une crise profonde, et que les marchands des idéologies rivalisaient de stratagèmes. On ne peut pas donner une définition exacte de l’identité car elle est subjective, mouvante et se crée dans les actes que nous posons. Il est donc aberrant d’imaginer, voire de créer un Ministère de l’identité nationale. De telles initiatives montrent la montée de la démagogie. Ce qui est hélas le cas en France depuis quelques années. Et le Front national n’a désormais plus le monopole de la surenchère.
J’ai retenu de ce débat que la France traversait une crise profonde, et que les marchands des idéologies rivalisaient de stratagèmes. On ne peut pas donner une définition exacte de l’identité car elle est subjective, mouvante et se crée dans les actes que nous posons. Il est donc aberrant d’imaginer, voire de créer un Ministère de l’identité nationale. De telles initiatives montrent la montée de la démagogie. Ce qui est hélas le cas en France depuis quelques années. Et le Front national n’a désormais plus le monopole de la surenchère.
Vous écrivez que « l’assistance n’est que le prolongement subreptice de l’asservissement ». Vous méfiez-vous des politiques d’aide au développement menées depuis les années 1950 par les pays occidentaux ?
L’aide arrive rarement à ceux qui en ont le plus besoin, et c’est par le biais de l’assistance que les anciens colonisateurs tiennent les États africains. En ce sens, nous sommes dans une colonisation déguisée. On même l’impression que c’est l’Occident qui choisit les présidents africains et décide de les décapiter lorsque ceux-ci essayent d’installer une rupture. Dans ces conditions, les indépendances africaines ne sont que des mots vides de sens.
Vous avez des mots très durs contre Éric Zemmour et ses propos récents. Mais ne pensez-vous pas que le refus de la victimisation noire que vous défendez dans votre livre trouverait un écho favorable chez lui ?
Pour critiquer les autres il faut faire son autocritique. Je dirais même, pour parodier un discours connu, que Zemmour pose de bonnes questions mais donne sciemment de mauvaises réponses, pour alimenter un fonds de commerce dont il a seul le secret. Il y a une attitude de victimisation dans le monde noir. C’est un fait indéniable. Mais pour autant je ne peux pas imputer aux Noirs la responsabilité de tous leurs malheurs. Il y a une part « blanche », mais dois-je consacrer mon existence à m’occuper de ce que le Blanc m’a fait ou de ce que je devrais faire ici et maintenant pour préparer mon avenir ? Là est la question.
Dans votre jeunesse, pour un jeune Africain, venir en France était une sorte de rêve, quasiment « un pèlerinage à la Mecque ». Est-ce toujours le cas aujourd’hui ?
La France reste pour beaucoup d’Africains un Paradis. C’est sans doute le cas pour toutes les anciennes puissances coloniales, puisque le rêve du colonisé est de mettre les pieds dans le pays de son maître, espérant ainsi atteindre la civilisation qu’on lui a enseignée dans les manuels d’histoire où il n’y a jamais sa photo. Ce fait est illustré dans la littérature africaine : plusieurs romans mettent en scène l’arrivée du personnage principal en Europe, et ce voyage se termine généralement de façon tragique. L’Europe a su inventer le mythe de la civilisation parfaite et inculquer à ses anciens colonisés la fatalité d’une malédiction qui ne disparaîtrait qu’avec l’adoption de la civilisation occidentale.
Vous notez que les Africains sont très hostiles à la reconnaissance de la responsabilité noire dans l’histoire de la traite, d’où un silence de plomb sur la question. Comment le comprendre ?
 Alain Mabanckou, © Sébastien Dolidon - EveneOn nous a appris à toujours enjoliver l’histoire africaine. C’est ce que le mouvement de la négritude a fait dans les années 1930 jusqu’aux indépendances africaines. Dans l’esprit de beaucoup d’Africains, l’Afrique était un continent paisible, et l’Europe est venue troubler cette quiétude. Mais qu’en est-il de l’esclavage des Noirs organisé par les Noirs ou les Arabes, bien avant l’arrivée du Blanc ? Il n’y a qu’à regarder la condition de l’homme noir dans le monde arabe pour se faire une idée. Dans cette région, le Noir est presque un objet. On ne le voit pas dans la société. Il n’est pas à la télé. Il n’occupe pas de hautes fonctions. Il y a des Noirs algériens, marocains, tunisiens. Et ils sont brimés de nos jours. Personne n’en parle… parce que c’est un tabou. Parce que celui qui oserait en parler serait forcément considéré comme un traître. C’est ce qui est arrivé au grand écrivain malien qui avait abordé le sujet dans son magnifique roman Le devoir de violence, paru au Seuil en 1968…
Alain Mabanckou, © Sébastien Dolidon - EveneOn nous a appris à toujours enjoliver l’histoire africaine. C’est ce que le mouvement de la négritude a fait dans les années 1930 jusqu’aux indépendances africaines. Dans l’esprit de beaucoup d’Africains, l’Afrique était un continent paisible, et l’Europe est venue troubler cette quiétude. Mais qu’en est-il de l’esclavage des Noirs organisé par les Noirs ou les Arabes, bien avant l’arrivée du Blanc ? Il n’y a qu’à regarder la condition de l’homme noir dans le monde arabe pour se faire une idée. Dans cette région, le Noir est presque un objet. On ne le voit pas dans la société. Il n’est pas à la télé. Il n’occupe pas de hautes fonctions. Il y a des Noirs algériens, marocains, tunisiens. Et ils sont brimés de nos jours. Personne n’en parle… parce que c’est un tabou. Parce que celui qui oserait en parler serait forcément considéré comme un traître. C’est ce qui est arrivé au grand écrivain malien qui avait abordé le sujet dans son magnifique roman Le devoir de violence, paru au Seuil en 1968…
Que pensez-vous des théories sur la trahison des écrivains africains qui écrivent dans une autre langue (le français en particulier), et qui s’installent en Europe ?
Certains écrivains veulent se détacher de la langue française – et donc de la France. C’est certes une initiative originale. Mais sur le terrain nous assistons à une situation cocasse : les mêmes écrivains qui demandent la rupture avec la France acceptent les distinctions que celle-ci leur offre. C’est le cas par exemple de l’écrivain camerounais Patrice Nganang, qui est le chef de file des « francophobes » mais qui est venu récemment à Paris pour prendre sa Mention spéciale du Prix des cinq continents de la Francophonie pour un livre écrit en français et publié en France ! Paradoxe, non ? Eh bien, c’est ce que j’appelle « la littérature à l’estomac » : on critique, mais quand on a faim, on picore les miettes jetées par terre par ceux qu’on houspillait.
Dans le livre, un personnage vous critique en disant que vos propos reflètent finalement votre position sociale favorisée (vous êtes universitaire, intellectuel, vous voyagez beaucoup, etc.), qui vous coupe du « peuple Noir ». Qu’en pensez-vous ?
La position que j’occupe n’est pas le résultat d’un quelconque « héritage » de classe sociale. Je ne viens pas d’un milieu social aisé. Mes défunts parents étaient des gens ordinaires – ma mère était illettrée, comme je le souligne dans mon roman Demain j’aurai vingt ans. Mon père était un réceptionniste dans un petit hôtel de Pointe-Noire. En France j’ai vécu à Garges-les-Gonesses, à Sarcelles, à Château-Rouge, dans le 18ème arrondissement et à Montreuil, dans le 93. Ce que j’ai dans ma vie, je l’ai eu par la force de mon travail. Et peut-être aussi parce que je refusais ce que les autres acceptaient : la malédiction de l’homme noir.
Vous suggérez finalement, pour combattre la vision fantasmée et politisée d’une Afrique victime et unie, de parler d’Afriques, au pluriel. Que voulez-vous dire ?
L’Afrique est variée, multiple. Et les Africains doivent apprendre à se connaître. Un Sénégalais, un Antillais, un Guyanais et un Congolais ne se connaissent pas forcément et, pour s’exprimer, ils passent par le français. Mais il se trouve toujours des démagogues pour nous dire qu’il y a une Afrique, une seule, avec une seule culture ! Et on nous parle de la communauté noire en France. Dans mon livre, je souligne que cette communauté n’existe pas. De même que l’Afrique, qui reste à inventer au présent, et non avec les vestiges du passé.
Le sanglot de l’homme noir, d’Alain Mabanckou
Fayard, 180 p., 15 €