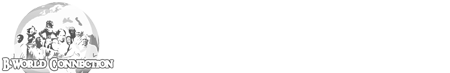LES LABOS PHARMACEUTIQUES EN ACCUSATION - Les enfants cobayes de Kan
 LES LABOS PHARMACEUTIQUES EN ACCUSATION - Les enfants cobayes de Kan
LES LABOS PHARMACEUTIQUES EN ACCUSATION - Les enfants cobayes de Kan
La firme américaine Pfizer avait testé des médicaments non autorisés lors d’une grave épidémie de méningite au Nigeria, en 1996. Une dizaine d’enfants en seraient morts.
Il y a des jours où Babatunde Irukera a le sentiment que plus rien ne peut aller de travers. A cause de toutes les preuves qu’il a réunies, des lettres, des rapports, des procès-verbaux, de tous les témoins qu’il a pu retrouver. Ces jours-là, il pense qu’au bout de onze longues années il peut quand même y avoir une justice pour les enfants de Kano, pour le Nigeria, son pays natal, et aussi pour l’Afrique. Babatunde Irukera est avocat. Il représente l’Etat nigérian et l’Etat de Kano dans le procès qui est intenté au groupe pharmaceutique américain Pfizer. L’affaire remonte à 1996. Une épidémie de méningite avait frappé le Nigeria et 10 000 personnes avaient contracté la maladie. Pfizer en aurait profité pour tester un nouveau médicament qui n’était pas encore autorisé. Or 11 des enfants qui ont participé aux tests sont morts, d’autres sont devenus sourds, aveugles ou handicapés mentaux.
La scène se déroule au début du mois d’octobre dernier. Irukera est en train de prendre son petit déjeuner à son hôtel quand la porte s’ouvre. Un vieil homme entre. Irukera le connaît, ils se sont rencontrés la veille au tribunal. La main du vieillard serre un sachet en plastique. L’homme tire du sachet un bout de carton rose froissé, c’est la moitié de la couverture d’un dossier. “Pfizer Meningitis Study” [étude méningite Pfizer], lit Irukera sur une étiquette jadis blanche apposée en haut à gauche ; au-dessous, un numéro : “Pf 0001”. En clair : “Patient Pfizer n° 1”. Le vieil homme, un ancien journaliste, a passé deux ans à rechercher les participants à ce test ; il a fini par en retrouver quelques-uns, dans les bidonvilles de Kano, la capitale de l’Etat éponyme du nord du Nigeria, là où la méningite a sévi il y a onze ans. Le carton rose est celui d’un enfant, âgé de 5 ans à l’époque, sexe masculin, poids 12,5 kg. Seules ses initiales figurent sur le carton. A. M. est arrivé à l’hôpital le 3 avril 1996. Trois rendez-vous de contrôle ont été notés au feutre noir sur le carton. Le petit garçon devait se présenter à l’hôpital le 14 mai pour les derniers examens. Babatunde Irukera fixe le carton du regard. Le patient 0001 devrait avoir 16 ans aujourd’hui. Il aimerait bien savoir si ce dernier souffre de séquelles. Car il mériterait d’être indemnisé. Le procès intenté à Pfizer pourrait générer plus de 9 milliards de dollars de dommages et intérêts.
Irukera est un jeune avocat, il vient d’avoir 39 ans. Jusqu’à présent, il s’était occupé d’affaires relevant du droit de l’immigration ou de discrimination sur le lieu de travail. Or il s’attaque maintenant au plus grand groupe pharmaceutique du monde : 100 000 salariés, 48 milliards de dollars de chiffre d’affaires - plus de la moitié du revenu national du Nigeria. Et il doit aujourd’hui faire face à quatre procédures, deux à Kano, deux à Abuja [capitale du Nigeria], avec chaque fois une au civil et une au pénal. Le groupe pharmaceutique, accuse l’avocat dans sa plainte, a traité ces patients comme des souris de laboratoire. Pfizer répond que son intervention au Nigeria était “un geste humanitaire”. Qu’en est-il ? Il faut revenir sur les faits.
Le Nigeria a été frappé début 1996 par la pire épidémie de méningite de l’Histoire. Quand elle a pris fin, les autorités avaient dénombré plus de 11 000 morts. Pfizer développait à l’époque un nouvel antibiotique appelé Trovan, censé empêcher la multiplication des bactéries. Des médicaments de ce genre sont surtout utilisés dans les hôpitaux, principalement dans les cas de septicémie. Mais ils présentent des effets secondaires tellement importants qu’ils sont contre-indiqués chez les enfants.
Ils risquent en effet de provoquer des déformations des cartilages et des articulations et d’être toxiques pour le foie. En général, ces médicaments sont administrés par voie intraveineuse, seul moyen pour qu’ils soient efficaces. Les premiers tests avaient conduit Pfizer à espérer que le Trovan pouvait également être efficace s’il était administré par voie orale, sous forme de comprimés. Pfizer espérait manifestement supplanter Bayer - qui était leader sur le marché - avec cette nouveauté. Le Trovan, pensait-il, avait le potentiel d’un blockbuster [médicament qui procure des recettes très importantes à la société qui le commercialise].
Mais Pfizer avait un problème : il lui fallait encore réaliser une étude clinique pour que l’usage du Trovan soit autorisé par la Food and Drug Administration, l’administration américaine en charge des médicaments. L’épidémie de méningite du Nigeria tombait donc à pic pour réaliser une étude apportant la preuve que le nouveau médicament convenait aussi aux enfants.
Dans les pays industrialisés, rares sont les parents qui sont prêts à mettre leurs enfants à la disposition des chercheurs pour la réalisation d’une étude clinique. Les groupes pharmaceutiques se tournent donc volontiers vers l’Inde, l’Amérique du Sud, le Bangladesh, la Thaïlande ou l’Afrique. Les malades sont tellement pau¬vres qu’ils se moquent que le médicament qu’on leur donne soit autorisé ou non. En quelques années, les pays en voie de développement sont devenus un immense laboratoire de recherche. Pfizer a proposé son aide au gouvernement nigérian début 1996 et une équipe de médecins est partie en Afrique dès fin mars. Arrivés à Kano, les Américains ont fait savoir que l’aide humanitaire qu’ils proposaient consistait en fait à tester un médicament. Les médecins ont sélectionné 200 enfants malades. Ceux-ci devaient avoir un âge compris entre 3 mois et 17 ans et ne devaient être ni infectés par le VIH ni sous-alimentés. Les tests ont très vite commencé : la moitié des enfants ont ingéré du Trovan tandis que les autres ont reçu de la Rocephin, un produit concurrent fabriqué par le groupe suisse Hoffmann-La Roche.
Cinq ans plus tard, la publication des résultats de l’étude déclencha une polémique sur des questions fondamentales auxquelles Irukera et le groupe Pfizer apportent des réponses diamétralement opposées : est-il admissible de tester un médicament pendant une épidémie meurtrière ? est-il admissible de tester dans le tiers-monde, sur des personnes qui ne pourront jamais se les payer, des médicaments qui profiteront au premier monde ? Nul ne conteste que les médicaments doivent être testés, y compris sur des êtres humains, avant d’arriver sur le marché. Le risque fait partie du test. La question fondamentale est de savoir qui doit prendre les risques, quelles vies on a le droit de mettre en jeu lors de ces expériences.
Avant 1996, le Trovan n’avait jamais été administré par voie orale à des enfants atteints de méningite. Les malades souffrent souvent de nausées, et risquent de vomir le médicament avant qu’il ne soit absorbé. Le médecin ne dispose que de très peu de temps pour éviter des lésions du cerveau et seule une injection lui donne la certitude que le médicament agira vite. Irukera s’est demandé comment on avait pu administrer du Trovan par voie orale à ces enfants. L’équipe de Pfizer a manifestement violé plusieurs règles fondamentales. La patiente 0069, par exemple, une petite fille, a reçu 56 milligrammes de Trovan le premier jour, et les médecins s’en sont tenus à ce dosage alors que son état se détériorait nettement. La petite fille est morte le troisième jour. Or les directives internationales relatives aux études cliniques prévoient que les patients qui ne réagissent pas au médicament testé doivent être immédiatement retirés de l’étude - d’autant qu’on avait avec la Rocephin un traitement éprouvé à disposition. Irukera déclare avoir longtemps cherché ce qui pouvait parler en faveur de Pfizer. Il fait une petite pause puis ajoute : “Je n’ai rien trouvé.”
Babatunde Irukera se tient près de la fenêtre de son bureau de Lagos, au neuvième étage, et il regarde la mer. Il entend les klaxons des motos, des taxis et des bus, il voit les camions et les petits vendeurs qui proposent bananes, sécateurs ou cartes de téléphone au milieu des voitures. Irukera - qui a quitté son pays natal il y a onze ans pour suivre sa femme aux Etats-Unis, où elle commençait des études, et qui est au¬jourd’hui associée dans un cabinet d’avocats de Chicago - porte une chemise bleu pâle au col blanc immaculé, une cravate assortie et un costume sombre. Si on faisait un film de cette affaire, ce serait un rôle parfait pour Denzel Washington. Il doit maintenant se rendre à une audience importante au tribunal de Kano, la ville qui fut le centre de l’épidémie il y a onze ans. Il souhaite élargir la plainte déposée contre Pfizer. C’est une démarche tactique, elle vise à adresser un signal au groupe pharmaceutique. “Pour qu’ils prennent la mesure du problème”, confie l’avocat. Dans le taxi qui l’emmène à l’aéroport, il tient un portable dans la main gauche et un BlackBerry dans la droite.
Un représentant du ministère public attend Irukera devant le palais de justice de Kano. Le Nigeria a porté plainte contre Pfizer début mai 1997. La plainte comporte 85 chefs d’accusation, dont abus de pouvoir et escroquerie. Irukera pense ne rien avoir oublié. Le procureur a décidé d’inclure le meurtre parmi les chefs d’accusation qui pèsent contre Pfizer. Irukera sourit.
Il porte maintenant robe, col cassé et perruque. Ce n’est qu’une fois dans la salle d’audience qu’il met son BlackBerry dans la poche de sa veste. Les procédures sont encore en phase préliminaire : pour le moment, Pfizer semble chercher avant tout à gagner du temps. Pendant qu’il expose son affaire, l’avocat de Pfizer - qui est assis à côté de lui - lui propose subitement un accord : si Irukera retire sa plainte, chuchote-t-il, Pfizer renoncera à la sienne, celle qui se trouve là, devant lui, sur la table. Irukera reste brièvement en haleine, se penche vers son confrère et échange quelques mots à voix basse avec lui. Puis il se redresse, se ressaisit et reprend son exposé comme si de rien n’était.
Au moment où Irukera quitte le tribunal, un député du People Salvation Party, portant calotte et vêtement traditionnel, s’entretient avec des journalistes à l’extérieur du tribunal. Le procès va durer une éternité, crie-t-il, les Américains ont une foule d’avocats, ils connaissent tous les trucs. “Nous, les Africains, nous n’avons aucune chance.” Les sociétés américaines sont sans pitié, “ça leur est égal s’il meurt 20 000 personnes chez nous, du moment qu’elles font des bénéfices”.
Le lendemain, Irukera se rend à Abuja, à quarante minutes d’avion de Kano. Il a rendez-vous avec Idris Mohammed, qui est peut-être son témoin le plus important. Mohammed, 65 ans, est professeur de médecine. C’est lui qui, à l’époque, assurait la coordination des mesures d’aide au nom du gouvernement. Outre la méningite, il fallait également combattre la rougeole et le choléra. La situation bactériologique n’était pas particulièrement bonne pour tester un nouveau médicament, commente Mohammed avec un léger sourire. C’est lui qui a demandé à Pfizer le certificat d’autorisation du médicament et qui, ne l’ayant pas reçu, a ordonné l’arrêt des tests.
L’équipe du groupe américain avait pris ses quartiers à l’hôpital de Kano, juste à côté de Médecins sans frontières. Les parents des enfants malades croyaient manifestement que les gens de Pfizer étaient des collaborateurs de cette organisation humanitaire. Ce n’est que quand Médecins sans frontières menaça de se retirer que Pfizer s’installa dans deux salles d’une aile un peu éloignée, un bâtiment de plain-pied aux fenêtres à barreaux. Une grille protégeait l’équipe des malades qui se pressaient dans la cour. Les médecins de Pfizer y accrochèrent en plus un rideau opaque pour boucher la vue.
Une fois, Mohammed a vu un jeune médecin de Pfizer prélever le liquide céphalo-rachidien d’un enfant d’environ 4 ans. Trois gouttes, quatre maximum, suffisent pour le diagnostic de la méningite ; le médecin en préleva plus de cinquante. Mohammed s’inquiéta pour la vie de l’enfant. Le liquide céphalo-rachidien protège le cerveau des chocs, il agit comme un amortisseur. Un adulte en a 120 à 200 millilitres, un jeune enfant beaucoup moins. Si on en prélève trop, le tronc cérébral risque de s’engager dans le trou occipital, par où passe la moelle épinière, ce qui peut endommager des centres vitaux et provoquer la paralysie ou la mort.
“A votre avis, il y a combien de liquide céphalo-rachidien chez un enfant comme ça ? demanda Mohammed au médecin.
 Un paquet, répondit le médecin.
Un paquet, répondit le médecin.
 Ça fait combien, un paquet, pour vous ?
Ça fait combien, un paquet, pour vous ?
 Plus de 1 litre.”
Plus de 1 litre.”
L’enfant est mort une heure plus tard.
Pfizer poursuivit l’étude malgré les injonctions de Mohammed. Ce n’est qu’à la mi-avril 1996, après avoir traité le 200e enfant, que l’équipe fit ses bagages et reprit l’avion, raconte Mohammed. “Le ‘geste humanitaire’ s’est terminé au moment où l’épidémie atteignait son apogée.”
Les bidonvilles d’où l’épidémie de méningite était partie se trouvent dans la banlieue de Kano. On y accède par une piste truffée d’ornières profondes et bordée de marchands de fruits, de ramasseurs d’ordures et de mosquées. Des hommes somnolent à l’ombre d’arbres desséchés, des chèvres paissent autour d’une station-service. C’est quelque part par là, dans une ruelle étroite, qu’habite Zaharadeen Abdullah. Aujourd’hui âgé de 18 ans, il avait 7 ans quand il a contracté la méningite. Zaharadeen est le sixième de 10 enfants. Ses parents ne savent ni lire ni écrire. Or les groupes pharmaceutiques doivent obtenir le consentement des parents avant de tester un médicament sur un enfant - même dans le tiers-monde. Ils doivent faire comprendre aux parents que le médicament en question est en phase d’essai et qu’on ne connaît donc pas sa dangerosité ni son efficacité. Ils doivent leur expliquer qu’il existe d’autres solutions, des médicaments éprouvés, et qu’ils ont le droit de quitter l’étude à tout moment.
La mère de Zaharadeen explique qu’ils ont entendu parler de l’aide apporté par les médecins blancs à la radio. Qu’est-ce que les médecins blancs lui ont raconté ? “Rien, répond-elle. Ils ont noté le nom de Zaharadeen, ils lui ont donné un cachet et on est rentrés à la maison.” Zaharadeen présentait depuis le début des symptômes de paralysie, les muscles de ses jambes étaient brûlants, raconte-t-il. Aujourd’hui encore il a parfois des douleurs tellement fortes qu’il doit passer des semaines allongé sur un matelas. Une rue plus loin vit Safiya Sani Isa, dont le fils n’a pas survécu au test. Est-ce que les médecins lui ont dit qu’ils travaillaient pour Pfizer ? Non, répond-elle. “On croyait qu’ils étaient venus aider nos enfants. On ne savait pas qu’on avait le choix entre Médecins sans frontières et eux.” Pfizer a longtemps gardé le silence devant ces accusations. En 2001, ses collaborateurs ont assuré à une commission d’enquête nigériane que cette étude clinique “était dépourvue de toute arrière-pensée commerciale”. Mais, maintenant que le procès est en vue, le groupe a changé de stratégie. Il veut reprendre le contrôle de la situation. Quand on appelle le siège nigérian du laboratoire, on tombe sur une femme qui ne révèle que son prénom, Sharon, chargée d’organiser les contacts avec l’état-major de New York. Elle demande ce qu’on veut savoir, avec qui on a déjà parlé au Nigeria, qui on va encore rencontrer. Deux jours après notre demande, le Dr Jack Watters nous rappelle de New York. Vice-président pour les affaires médicales extérieures - en charge de la corporate responsability* [responsabilité de l’entreprise] et des human rights* [droits de l’homme] -, il a un accent britannique et une voix agréable. Il nous promet de s’efforcer de répondre à toutes nos questions.
Les parents avaient-ils donné leur accord ? Bien sûr, assure-t-il. Une infirmière agréée a noté leur déclaration et signé en leur nom. Les effets secondaires ? On ne connaissait pas à l’époque, affirme Watters, les risques pour les os, les articulations et le foie, surtout chez les enfants. “Nous n’avons eu connaissance des effets secondaires du Trovan que quand il est arrivé sur le marché, deux ans après les études cliniques.” Watters étant chez Pfizer depuis 1994, il devrait pourtant être un peu mieux informé. Il devrait savoir que les effets secondaires du groupe de médicaments auquel appartient le Trovan sont connus depuis au moins 1992. De plus, les gens de Pfizer ont, dans le compte rendu qu’ils ont eux-mêmes rédigé à Kano en 1996, observé un taux nettement plus élevé de problèmes articulaires chez les enfants à qui l’on avait administré du Trovan que chez les autres. Ce sont 15 % des patients qui se plaignaient de douleurs, soit trois fois plus qu’avec l’autre médicament. “Et le patient 0069 ? La petite fille à qui on a continué à donner du Trovan alors qu’elle allait plus mal ? De quoi est-elle morte ?” Watters ne connaît pas les détails de ce cas, “sorry*”. Interrogés, les responsables de Pfizer n’ont pas souhaité s’exprimer sur des cas individuels.
Le groupe pharmaceutique rejette toutes les accusations. Selon lui, on ignore totalement si les enfants sont morts à cause des tests ou des suites de la méningite. Il semble rechercher un accord à l’amiable. Cela ferait probablement sensation dans les annales judiciaires si un tribunal nigérian condamnait un groupe américain à des milliards de dollars de dommages et intérêts...
Une cabane de torchis, dans un des bidonvilles de Kano. C’est là que vit Anas Mohammed, 16 ans, fils de Mohammed Mustapha. La maison n’a ni électricité ni eau courante. Anas y partage un recoin avec ses 12 frères. Anas Mohammed, c’est A. M., le patient 0001, dont le dossier a été apporté à Irukera. Il avait alors 5 ans et pesait 12,5 kg. Aujourd’hui père et fils sont assis sur un banc à l’ombre, il n’y a pas un nuage dans le ciel, il fait 37 °C.
Mohammed Mustapha, les médecins vous ont-ils expliqué quoi que ce soit à l’hôpital ?
“Non.”
Est-ce que quelqu’un vous a expliqué quoi que ce soit ?
“Non.”
Est-ce que vous avez dû signer quelque chose ?
“Non.”
Saviez-vous que les médecins ne travaillaient pas pour Médecins sans frontières mais pour Pfizer, un grand groupe pharmaceutique ?
“Non”, répond Mohammed Mustapha avec un sourire incertain.
Il repousse un rideau de paille et fouille dans une caisse qui se trouve derrière son lit. Il refait surface, un classeur blanc à la main. Il a gardé tous les documents officiels qu’il a reçus dans sa vie. Anas explique qu’il a encore les genoux raides. Il a longtemps été soigné pour ça, avec le temps ça s’est un peu amélioré. Il a survécu au “geste humanitaire”, mais ne retrouvera jamais une bonne santé. Les douleurs réapparaissent dès qu’il marche longtemps.
Anas s’absente et revient quelques minutes plus tard avec une seringue en plastique rose à la main. Dessus il y a une roulette ; quand on pousse le piston, la roulette est censée tourner et cracher des étincelles. La roulette est cassée depuis longtemps, mais Anas a gardé la seringue, c’est son seul jouet. Les gens de Pfizer la lui ont offerte après la dernière consultation, en guise de récompense.
* En anglais dans le texte.
Hauke Goos
Der Spiegel
http://www.courrierinternational.com/article.asp ?obj_id=80120#
A LIRE AUSSI:Apartheid médical, les Noirs des Etats-Unis utilisés comme cobayes