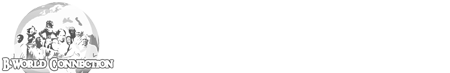De l'Afrique à la Guadeloupe: être Africain aux Antilles
De l'Afrique à la Guadeloupe: être Africain aux Antilles
Selon un rapport de l'INSEE, 680 Africains étaient installés en Guadeloupe en 2006, dont une forte proportion de natifs d'Afrique Noire. Regard sur ces Africains de Guadeloupe aujourd'hui.

«Les Africains ne connaissent pas les Antilles, ils ne savent même pas les situer sur une carte». C'est lors d'un séjour au Sénégal, à Saint-Louis, que cette réflexion me frappa. Je m'étais retrouvée, au fil du hasard, à boire les paroles d'écrivains sénégalais émérites qui faisaient part des liens, empreints d'un profond respect, qu'ils entretenaient avec des auteurs Haïtiens. Négritude, créolité...
Quel plaisir d'entendre discuter de ces mouvements littéraires à des kilomètres des Caraïbes. L’idée me vint alors de sonder les liens entre Africains et Antillais. Car, pour tout dire, j’ai débarqué aux Antilles, et plus précisément en Guadeloupe, en 1994, à l’âge de six ans. Née à Quimper de parents Guinéens, je changeais de pays, je changeais de vie. Dans toutes les écoles, de la maternelle au lycée, les élèves portent un uniforme. Et pourtant, cela ne m’empêcha pas d’être stigmatisée au même titre que les Haïtiens ou les Dominicains.
«Sale Africaine!», me lançaient mes camarades. «Il est où ton pays?», me demandaient les surveillantes. Je voulais bien leur répondre, à elles: «C'est la Guinée». Cette chère Guinée-Conakry, qu'à cette époque, je n’aurais même pas su situer sur une carte…
Retour donc à Karukéra —nom originelle de la Guadeloupe— où j’ai rencontré des Africains et des Antillais avec qui j’ai discuté… de ce que c’est d’être Africain aux Antilles.
La négresse de Guinée
«Soti an soley la negress jjiné!»
Françoise rit encore quand elle repense à cette réprimande de sa mère tandis qu'elle courait pieds nus sur le béton chauffé à blanc par le soleil martiniquais, dans la petite commune du Lorrain. «Ne reste pas au soleil espèce de négresse de Guinée!».
Une insulte pour le moins prémonitoire puisqu’aujourd’hui, cette Martiniquaise de 61 ans, infirmière à la retraite, vit en Guadeloupe, mariée depuis 1986 avec un natif de la Guinée-Conakry, patricien hospitalier en urologie.
«La Guinée est ma deuxième patrie», déclare-t-elle aujourd’hui. «Petite, j'ai toujours rêvé d’Afrique.»
Quand la mère de Françoise a su qu’elle sortait avec un Africain, elle s’est mise à pleurer. «Elle pensait que j’étais amoureuse d’un cannibale qui allait me faire cuire dans un chaudron puis danser autour». Françoise rit de plus belle. C’était au début des années 80, à l’époque où elle exerçait en France, à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Autant dire que l’imaginaire autour de l’homme africain ne devait rien à Aimé Césaire et autres chantres de la négritude…
Françoise est allée plusieurs fois en Guinée et aujourd’hui, elle se voit bien s’installer dans la région du Fouta-Djalon, là où il fait bon vivre. Avec Lamine, son époux, ils sont arrivés en Guadeloupe en mai 1993 suite à la mutation de celui-ci de la Pitié-Salepêtrière au Centre Hospitalier Universitaire de Pointe-à-Pitre.
«En Guadeloupe, on retrouve le même climat qu’en Guinée donc on est moins dépaysé. Ce qui change, c’est le côté insulaire. Mais on s’intègre facilement même si les gens ont un caractère qui n’est pas toujours facile», explique Lamine.
«Pour tout dire, la Guadeloupe est le seul endroit où je me suis fait traiter de "sale Africain" malgré mes nombreuses années passées en Métropole. Là-bas, le racisme est latent mais ici, on te l’envoie en pleine figure: "Sale Africain, tu n’es pas chez toi ici!". La deuxième fois que l’on m’a fait cette réflexion, un infirmier de mon service est venu prendre ma défense contre une Antillaise qui venait de métropole. Quand les Antillais reviennent ici, ils trouvent les Africains à des postes de responsabilité alors qu’en France, c’est moins courant», juge-t-il.
Il estime, malgré tout, que vivre en Guadeloupe est extrêmement plaisant. «Il y a un racisme qui ne s’exprime pas: des regards quand je porte mes tenues africaines ou de petites réflexions qui ont l’air innocentes».
L’Afrique à Pointe-à-Pitre
En vous baladant dans les rues de Pointe-à-Pitre, la capitale économique de la Guadeloupe, soyez certains de tomber sur une ribambelle de personnages hauts en couleurs. Je m’arrête d’abord au Centre Culturel Rémy Nainsouta, sur le Boulevard Légitimus. Au premier étage, un artiste plasticien guadeloupéen expose ses œuvres. Il s’appelle Cedrick Bookart, a une trentaine d’années, et propose des sculptures et des compositions picturales en relief.
«Mon travail n’est pas forcément orienté vers l’origine de ce que je suis culturellement, historiquement ou géographiquement. Et je trouve que cette question de crise identitaire attachée à la Guadeloupe est ridicule», déclare-t-il.
«Je ne me suis jamais demandé d’où je venais, par quel bateau mes aïeux étaient arrivés ici. Nous sommes dans une île métissée. Difficile de se réduire seulement à l’Afrique. Il ne faut pas oublier l’Inde par exemple. Beaucoup de Guadeloupéens martèlent que leurs racines sont en Afrique. Ce continent est uniquement mis en lumière par rapport à l’esclavage et je trouve ça plutôt dommage.»
Je continue mes pérégrinations vers le Musée L’Herminier, à l'angle des rues Jean Jaurès et Sadi-Carnot. Un homme en boubou est assis sur le perron. Il griffonne puis regarde autour de lui. «Je m’appelle Ickanga», me dit-il dans un accent créole qui me fait sourire. «Ickanga? C’est vraiment votre nom?» L’homme s’énerve un brin. «Ecoute jeune fille, tu ne vas pas me sortir un discours de colonisée. Je viens d’Afrique moi!». Tout est dit.
Il m'explique qu’il apprend les similitudes entre le créole et plusieurs dialectes africains. «C’est intéressant! Dans ma langue, ‘Awa’ veut dire ‘d’accord’ et en créole ça veut dire ‘non’», lui dis-je. Il sourit puis le note sur un coin de sa feuille avant d’ajouter qu’il prépare un discours en créole pour une conférence sur l’Afrique qui a lieu le lendemain dans la Zone Industrielle de Jarry. Peu avant la fin de la journée, je recroise Ickanga dans Pointe-à-Pitre, avec son sac à dos en forme de kwi (la moitié d’une calebasse), parsemé de koris.

Ickanga devant le Musée L'Herminier © Katia Touré
Nous sommes tous frères
En onze ans, de nombreuses boutiques «africaines» ont fleuri à Pointe-à-Pitre. Une culture qui plaît surtout aux femmes, si l'on en croit les vendeuses: robes en wax, bijoux, encens, statuettes, sacs,... Je m'adresse à l'une des clientes d'une boutique tenue par une Congolaise et un Français blanc.
«J'aime beaucoup les robes et tissus africains, les tenues traditionnelles. J'aime aussi leur musique. J'écoute beaucoup Youssou N'Dour et Mory Kanté. Ici, je trouve que les Africains se sont bien intégrés et je ne vois pas pourquoi nous devrions avoir des soucis avec eux», me rapporte Isabelle. «Nous sommes tous frères», conclut-elle.
Ce n'est pas Fatou qui dira le contraire. Cette Guinéenne d'une quarantaine d'années, installée en Guadeloupe depuis dix ans, tient un stand de produits africains non loin du marché aux épices, sur la rue piétonne.
«Je me sens très bien en Guadeloupe. Je suis venue rejoindre mon mari qui tient un restaurant dans le quartier de Grand-Camp aux Abymes. J’ai mon petit commerce et ça marche bien. La plupart de mes clients sont des Antillais. Ils sont friands du savon noir, du beurre de karité, et de l’encens», m'explique cette femme habillée d'une robe en bazin flamboyante.
«Je n’ai aucun problème avec les Guadeloupéens. Ils adorent les Africains. Je ne me sens pas du tout dépaysée. Beaucoup viennent me parler de l’Afrique et on échange sur nos cultures respectives. J’ai une vieille voisine qui m’a même appris à cuisiner le colombo et le kalalou».
A côté de d'elle, une Sénégalaise tient également un stand de bijoux. Fatou me prévient. «Elle est trop mauvaise, il ne faut pas lui parler». Je me rends compte alors, que d’un pays à l’autre, les Africains de la diaspora ne sont pas plus unis… Pour ne pas la froisser, je continue mon chemin.
80% des Guadeloupéens ne connaissent pas l'Africain
La nuit tombe rapidement sur Pointe-à-Pitre. Je me retrouve en face de la Tour Faidherbe. Au quinzième étage de cet immeuble désuet, on trouve les locaux de «Radyo Tanbou», une radio locale indépendantiste. Après avoir grimpé les quinze étages de l'immeuble sans ascenseur, je me retrouve en grande conversation avec Alphonse Rancel et Roger Mancliêre, animateurs de la radio qui n’émet qu’en créole.
En marge du sujet à l'origine de notre entrevue, on évoque la Guinée de Sékou Touré, les Duvalier (père et fils) en Haïti, le discours de François Hollande aux élus d'Outre-mer mi-novembre, ou encore une bonne partie des maux, qui selon eux, gangrènent leur île. Roger se considère comme Africain et souhaite y aller pour retrouver ses ancêtres et, surtout, pour «se retrouver». Selon lui, une partie des Guadeloupéens sont perdus et n'ont pas de repères.
«Les Africains qui vivent en Guadeloupe sont invisibles aux yeux de la population locale», note-il. Alphonse renchérit: «80% des Guadeloupéens ne connaissent pas l’Africain qui travaille en Guadeloupe. Il ne le voit pas. Or, beaucoup il existe ici beaucoup d’associations de communautés béninoises ; camerounaises, sénégalaises, maliennes, guinéennes ou encore ivoiriennes. Ces Africains travaillent, pour la plupart, dans les domaines de la santé, de la justice ou alors dans entrepreneuriat. Mais pour le Guadeloupéen moyen, un Africain est forcément un marabout».
Alphonse met en avant un problème d'éducation.
«Quand j'étais jeune, on nous as appris que tout le mal de la terre venait d'Afrique. La perception qu'ils ont des Africains est la même qu'ils ont des Haïtiens ou des Dominicains. On nous a tellement raconté que nous sommes supérieurs et qu'ils sont inférieurs. Vous trouverez des Guadeloupéens vous dire que c'est grâce à l'esclavage qu'ils ont la peau claire ou que nous ne venons pas d'Afrique», déplore-t-il.
On est originaire de l’endroit où l’on a ses repères
Pour John, un avocat béninois de 57 ans exerçant en Guadeloupe depuis plus de trente ans, «il n'y a pas vraiment de malaise entre les Africains et les Guadeloupéens». Son intégration dans l'île, il la décrit comme normale et naturelle.
«J’ai pris mes repères en Guadeloupe. Au quotidien, je me sens plus guadeloupéen qu’Africain. Quand je pars en vacances en Afrique, je m'ennuie déjà au bout d'une semaine. Pour moi, on est originaire de l’endroit où l’on a ses repères», raconte-t-il.
John a fait ses études en métropole et a travaillé pendant dix ans à Paris.
«J’y ai fait la connaissance d’une Guadeloupéenne que j’ai épousé. Quand je suis venu en vacances ici, je me suis aperçu que je pouvais mieux évoluer professionnellement et obtenir un meilleur de confort de vie qu'à Paris».
A son arrivée, il a choisi de se fondre dans la masse.
«Si je ne parle pas, il est impossible de se rendre compte que je suis Africain. Et même quand l'on entend mon accent, on me prend pour un Haïtien». Aujourd'hui, il n'y aurait que sept avocats d'origine africaine à exercer en Afrique, selon lui. «Au niveau professionnel, je n'ai jamais senti de différence entre les confrères. Le racisme entre les communautés Africaines et Antillaises est plus visible en métropole. Mais ici, il est certain que si vous évoluez dans un milieu d'intellectuels, vous serez moins confrontés au racisme que si vous êtes en bas de l'échelle».

Une boutique africaine à Pointe-à-Pitre © Katia Touré
Vive le «multi-racinement»!
Pour ma part, de la Guadeloupe à la Martinique —ces deux îles, anciennes colonies françaises aujourd'hui dénommées départements et régions d'Outre-Mer— je me suis parfois heurtée à un racisme sans vergogne. A commencer par ma couleur de peau: j’étais noire « comme du charbon ». Et puis le nom «Touré », ça ne trompait personne. De là, découlait donc mon «africanité»: d’un nom et d’une peau bien noire.
De retour en France, en 2003, à l’âge de 15 ans, les Antillais, je les ai oubliés. Ceux de métropole, ils n’étaient pas comme ceux de là-bas (j’ai d’ailleurs appris plus tard qu’on les appelle, en Guadeloupe, les «négropolitains»). J’ai oublié le créole au profit de ma langue maternelle, le diakhanké, j’ai oublié cette culture dans laquelle j’avais baigné pour mieux me lier d’amitié avec des Guinéens et des Africains, comme moi —malgré mon accent «gwada» et mon peu de connaissances sur les valeurs africaines. Dur labeur que de se «communautariser» quand on est, de fait, «multi-racinée».
Au fil des années, j’ai appris à être fière de mon «multi-racinement», à le considérer comme une richesse. Je raconte, à qui veut bien l'entendre, que je suis «Guinéenne-Diakhanké-Française-Quimperoise-Guadeloupéenne». Un sacré pot-pourri dont, je le répète, je ne suis pas peu fière. Après près de dix années de lutte avec ma propre identité, je dois dire que, désormais, je m’évertue à considérer la société comme une masse indivisible —malgré les affres de la réalité— et que, bien plus que ma couleur de peau, mon vécu à travers les frontières est le socle sur lequel repose ma personnalité.
Katia Touré